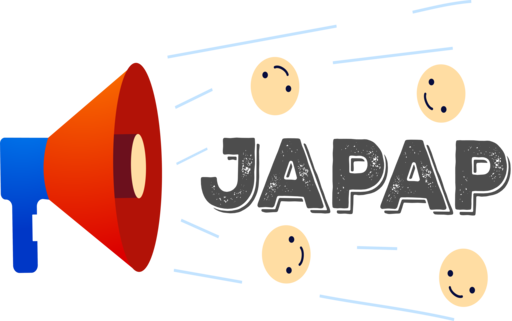Crise humanitaire en Mauritanie : la détresse des migrants entre refoulements, violations et silence international
Depuis début 2024, la situation des migrants gambiens en Mauritanie est devenue un sujet de préoccupation croissante, tant pour les défenseurs des droits humains que pour les autorités gambiennes. Face aux expulsions massives et aux conditions de détention jugées inhumaines, le gouvernement de la Gambie a réagi en envoyant son ministre des Affaires étrangères, le Dr Mamadou Tangara, en Mauritanie comme envoyé spécial afin d’intervenir, négocier et, surtout, assurer la sécurité de ses ressortissants.
Contexte de la crise : un durcissement politique
La Mauritanie, pays de transit souvent sollicité par des migrants d’Afrique de l’Ouest désirant atteindre l’Europe, notamment les îles Canaries en Espagne, a intensifié depuis peu sa politique de lutte contre l’immigration irrégulière.
Cette politique prend surtout la forme de :
- Rafles et arrestations massives dans les grandes villes comme Nouadhibou ou Nouakchott ;
- Expulsions systématiques, souvent sans procès équitable ni consultations consulaires ;
- Coopération renforcée avec l’Espagne, dans le cadre de la lutte contre le trafic d’êtres humains vers l’UE.
Les autorités espagnoles, avec le soutien de l’Union européenne, financent et équipent les forces de sécurité mauritaniennes dans leurs efforts de contrôle des routes migratoires. Une stratégie jugée efficace par les autorités européennes… mais aux lourdes conséquences humaines.
Migrants gambiens: arrachés à la vie, abandonnés à la frontière
Plusieurs dizaines de migrants originaires de la Gambie ont été arrêtés ces dernières semaines. Certains ont signalé avoir été détenus dans un hangar insalubre, sans ventilation, ni accès régulier à la nourriture ou à l’eau. L’un d’eux, surnommé Jason Brown, explique :
« Nous souffrons vraiment ici en Mauritanie… nos vies ne sont plus en sécurité. »
Détenus, parfois sans explication formelle, ils sont ensuite conduits vers des points de passage à la frontière, notamment la ville de Rosso, dans la région Nord du Sénégal, où ils sont abandonnés à leur sort, souvent sans argent, sans contacts locaux, ni même de soutien humanitaire formel.
Conditions à Rosso : exil dans l’oubli
Rosso, bien qu’étant un carrefour transfrontalier important, n’a ni les infrastructures, ni les services nécessaires pour accueillir un afflux imprévu de dizaines, voire centaines de migrants. Les exilés racontent y vivre sans abri, dormant à la belle étoile ou sous des structures de fortune. L’un d’eux confie :
« Ce dont nous avons vraiment besoin en Mauritanie actuellement, c’est de l’aide humanitaire, parce que le gouvernement garde le silence et nous laisse mourir lentement à la frontière. » — Jason Brown
Les accusations de xénophobie et la réponse des autorités
Certains migrants affirment que leur expulsion serait motivée non pas uniquement par la régulation migratoire, mais aussi par des arguments raciaux et xénophobes. Ils dénoncent des cibles spécifiques contre les communautés d’Afrique de l’Ouest.
En réponse, le gouvernement gambien affirme avoir :
- Demandé à son ambassade d’intensifier le dialogue bilatéral avec les autorités mauritaniennes ;
- Renforcé sa présence diplomatique pour suivre le sort de ses citoyens ;
- Demandé le respect des conventions internationales relatives à la protection des droits des migrants.
Le rôle de l’Union européenne : protecteur ou instigateur?
La politique migratoire actuelle de la Mauritanie est, en grande partie, financée par l’UE dans le cadre de son « plan d’action sur la Méditerranée occidentale ». Un plan très critiqué par les ONG puisque, tout en limitant les arrivées en Espagne, il contribue aussi à :
- Externaliser les contrôles frontaliers vers des pays tiers peu rigoureux en matière de droits humains ;
- Créer des zones grises juridiques où les migrants peuvent être détenus arbitrairement ;
- Aggraver la souffrance des personnes en quête d’un avenir meilleur ou d’une protection humanitaire.
Exemple : les embarcations interceptées
Bon nombre de migrants, en quête du rêve européen, prennent la mer dans de petites pirogues pour tenter de rejoindre les îles Canaries. Ces embarcations, souvent surchargées et non adaptées à la haute mer, sont interceptées par la marine mauritanienne. Les passagers sont rapatriés ou, dans d’autres cas, bloqués à Rosso ou dans des centres de détention informels.